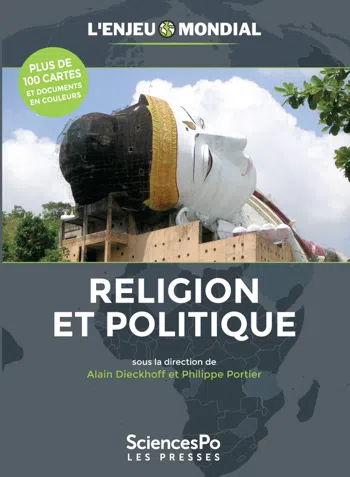 Un volume de référence et aux perspectives mondiales sur l’impact des religions dans le domaine politique est particulièrement bienvenu aujourd’hui, pour répondre aux besoins de connaissances documentées sur ces facteurs qui demandent une approche nuancée. Il faut saluer la publication, en 2017, d’un volume de plus de 350 pages, sous la direction d’Alain Dieckhoff et de Philippe Portier. Derrière les deux directeurs du volume, il y a les ressources scientifiques des institutions qu’ils dirigent : le Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI) de Sciences Po pour le premier, le Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRL) de l’École pratique des hautes études pour le second. Ainsi se trouvent réunis dans un seul volume, avec trente-trois auteurs, plusieurs des meilleurs chercheurs français étudiant la place des religions dans des environnements contemporains. Outre les riches informations qu’il apporte, ce volume apporte un témoignage la qualité des travaux de recherche produits par des universitaires français (auxquels s’ajoutent quelques autres) sur ces sujets qui retiennent l’attention des dirigeants politiques et du public aujourd’hui. Le but de ce volume n’était pas de le prouver, mais cela mérite d’être salué au passage.
Un volume de référence et aux perspectives mondiales sur l’impact des religions dans le domaine politique est particulièrement bienvenu aujourd’hui, pour répondre aux besoins de connaissances documentées sur ces facteurs qui demandent une approche nuancée. Il faut saluer la publication, en 2017, d’un volume de plus de 350 pages, sous la direction d’Alain Dieckhoff et de Philippe Portier. Derrière les deux directeurs du volume, il y a les ressources scientifiques des institutions qu’ils dirigent : le Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI) de Sciences Po pour le premier, le Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRL) de l’École pratique des hautes études pour le second. Ainsi se trouvent réunis dans un seul volume, avec trente-trois auteurs, plusieurs des meilleurs chercheurs français étudiant la place des religions dans des environnements contemporains. Outre les riches informations qu’il apporte, ce volume apporte un témoignage la qualité des travaux de recherche produits par des universitaires français (auxquels s’ajoutent quelques autres) sur ces sujets qui retiennent l’attention des dirigeants politiques et du public aujourd’hui. Le but de ce volume n’était pas de le prouver, mais cela mérite d’être salué au passage.
Religion et Politique est le premier volume d’une série dont le titre général est L’Enjeu mondial ; un nouveau volume devrait voir le jour chaque année, autour d’un grand thème. Ce premier titre offre un résultat convaincant. Il ne contient pas seulement des textes de synthèse de qualité, mais aussi de nombreuses illustrations et des graphiques intelligemment conçus pour accompagner les textes. On peut voir plusieurs de ces documents en ligne. Le site d’accompagnement du livre donne aussi accès à la bibliographie et à d’autres ressources documentaires : chaque chapitre a une page liée. En outre, ce projet est lié à l’Observatoire international du fait religieux (OIR), sur le site duquel on peut consulter des notes précises et des articles bien documentés, tous en accès libre.
À un prix très raisonnable, cela en fait un ouvrage que tout chercheur, étudiant, journaliste, diplomate ou simple curieux de langue française s’intéressant au rôle contemporain des religions se doit de posséder, pour y recourir quand surgit le besoin d’un éclairage sur une situation — en n’oubliant pas d’aller aussi explorer les ressources en ligne précitées.
Le volume n’a pas l’ambition de tout couvrir, mais il offre des informations concises et solides sur nombre de sujets qui surgissent dans l’actualité internationale : l’émergence d’un catholicisme global, la place des évangéliques, le rôle du Saint-Siège, les régimes de laïcité en Europe, les partis politiques et les religions en Occident, le djihadisme, les minorités chrétiennes au Proche-Orient, la politique religieuse de la Chine, le militantisme bouddhiste en Birmanie… Pour certains sujets attendus, l’angle choisi est original : par exemple l’Inde vue comme gourou du monde dans le nationalisme hindou et un néo-hindouisme mondialisé. Nous découvrons aussi des chapitres sur des sujets moins souvent mentionnés dans les médias, mais qui soulèvent de véritables enjeux et ouvrent des perspectives auxquelles beaucoup de lecteurs n’auraient pas pensé : le culte des saints dans l’islam et les réactions qu’il suscite, le syncrétisme brésilien face au nouveau marché du religieux, l’ONU comme forum privilégié des groupes religieux, la multiplication des revendications exprimées en termes d’objection de conscience…
Une introduction des directeurs du volume (accessible en ligne dans son intégralité) explique comment celui-ci s’inscrit dans le renouvellement des analyses de la présence des religions dans l’espace mondial contemporain. À la thèse de la désécularisation, expliquent-ils, il faut préférer celle de la polarisation des sociétés, pour décrire le double mouvement d’effacement et de réaffirmation de la croyance (p. 12). Peut-être est-ce aussi une manière de prendre acte de l’existence simultanée de tendances et aspirations contradictoires plutôt que d’un mouvement historique rectiligne. Pour autant, comme l’observent Dieckhoff et Portier quelques pages plus loin, le religieux qui resurgit n’est pas « une vague uniforme et englobante qui remettrait en cause le pluralisme propre à la modernité » (p. 19).
Le mot de « polarisation » ne doit pas être compris comme une opposition entre citoyens religieux et séculiers : « Les deux univers sont eux-mêmes divisés […] ce qui permet souvent l’existence d’un continuum moral au sein des sociétés concernées. » (p. 14).
Les modes revendicatifs du religieux et les mobilisations au nom de la religion « procèdent d’un projet de résistance à l’égard de la globalisation libérale du monde et des effets de déstructuration culturelle qu’elle entraîne » (p. 13). Deux autres éléments structurants sont pris en compte pour décrire la scène contemporaine : la politisation des croyances et la spiritualisation du politique. Ces deux éléments se déploient dans une interaction complexe avec la modernité, brossée à grands traits dans le chapitre introductif. Tout cela n’est pas simplement le fait de stratégies (offensives ou défensives) de groupes religieux : des États sont aussi demandeurs.
Il est impossible de résumer les trente chapitres qui suivent l’introduction, autour de grands axes thématiques. Cela ne saurait d’ailleurs être l’objectif d’un compte rendu. Bornons-nous à relever quelques observations recueillies pendant notre lecture, pour stimuler la réflexion sur la place et l’influence des religions dans le monde contemporain.
Les christianismes à l’heure de la mondialisation
Du côté chrétien, les auteurs prêtent attention à la place croissante du Sud. Mais Denis Pelletier se garde de tomber dans l’opposition de deux mondes, en mettant l’accent sur la globalisation pastorale, théologique et ecclésiologique du catholicisme : celle-ci procède « de l’imbrication d’une pluralité de mondes se réclamant d’une foi commune, dans un cadre où les échanges se multiplient, mais qui reste fortement institutionnalisé et hiérarchisé. Dans ce contexte, Vatican II joue le rôle d’un élément fondateur a posteriori : l’aggiornamento légitime la pluralité des manières d’être catholique tout en garantissant le rapport de chacune à l’unité de l’Église », mais obligeant aussi Rome à « repenser sa fonction de régulation » (p. 29). Innovation dans le gouvernement de l’Église, les synodes régionaux sont « devenus un lieu essentiel de régulation de la diversité catholique par le magistère romain » (p. 30).
Dans un autre chapitre et sous un autre angle, François Mabille souligne aussi cette diversité en notant pour sa part que « la politique internationale de l’Église catholique relève d’un espace culturel mondialisé qui rassemble plusieurs communautés épistémiques, empêchant cette institution supranationale d’être perçue comme une force monolithique et homogène » (p. 184).
Poursuivant de son côté son analyse de la globalisation catholique, Pelletier envisage le jeu diplomatique du Saint-Siège en lien avec le dialogue interreligieux (consacré par la rencontre d’Assise à l’initiative de Jean-Paul II en 1986), qui « sert de repère jusque dans le dialogue entre les confessions chrétiennes » (p. 32).

Dialogue, mais aussi dimensions de concurrence, notamment par rapport au dynamisme d’Églises évangéliques (avec lesquelles le dialogue existe d’ailleurs aussi, illustré par plusieurs rencontres du pape François) : Sébastien Fath évalue le nombre de leurs fidèles à 630 millions environ, mais avec une notable diversité interne, entre un pôle piétiste-orthodoxe et un pôle pentecôtiste-charismatique (p. 36). Ces données statistiques sont en partie estimatives, par exemple quand on pense à la difficulté de décider s’il convient d’appliquer ou non l’étiquette « évangélique » à certains nouveaux christianismes du continent africaine (p. 40). Les Églises évangéliques « mobilisent en priorité des populations qui aspirent au changement social et personnel » (p. 42). L’Amérique du Nord — où il est devenu la forme la plus courante du protestantisme, avec 97 millions de fidèles — n’en est plus le principal vivier, mais « constitue toujours son principal bastion en termes de puissance de projection et de moyens financiers » (p. 37).
Quels judaïsmes ?
Abordant le monde juif, l’observateur peu familier avec celui-ci a souvent du mal à se retrouver dans les différents courants qui se revendiquent de l’héritage juif. Joëlle Ayouche-Benayoun en dresse un clair panorama en quelques pages, après avoir rappelé que, sur une population mondiale estimée entre 12 et 16 millions, 43 % vivraient en Israël et 31 % aux États-Unis. La présentation du judaïsme est organisée autour d’un « pôle orthodoxe » et d’un « pôle moderniste », avec bien des déclinaisons au sein de chacun d’eux. Mais il ne faut pas limiter la diversité juive à ce seul affrontement : « la diversité et le pluralisme religieux […] dominent au sein du monde juif, probablement plus aujourd’hui que jamais auparavant. » (p. 82) Comme tout paysage religieux, il est mouvant, et pas seulement favorable à des mouvements réaffirmant une rigoureuse orthodoxie : par exemple, en France, au cours des quarante dernières années, on peut observer une multiplication de communautés juives libérales, alors qu’il n’existait qu’une seule synagogue de ce type jusqu’en 1977 (p. 87) — sans oublier aussi des associations juives laïques, plutôt à gauche (p. 89). Tous les groupes ont eu à se déterminer par rapport à l’existence de l’État d’Israël (p. 90).

En Israël, Alain Dieckhoff raconte le passage d’un nationalisme séculier à un nationalisme plus religieux après la guerre des Six Jours (1967), permettant au sionisme religieux de sortir de sa marginalisation. En outre, une partie des ultra-orthodoxes, initialement hostiles au projet sioniste, ont évolué vers des formes de nationalisme. À la faveur aussi de l’essoufflement de la gauche, « un nationalisme mâtiné de religion a, aujourd’hui, le vent en poupe en Israël » (p. 126).
Les mondes musulmans
Il n’est pas étonnant que les dimensions conflictuelles soient traitées dans plusieurs articles abordant l’islam : cela ne fait que refléter les turbulences politiques, sociales et religieuses qui traversent nombre de zones à majorité musulmane. Mais les auteurs ne s’y bornent pas et, surtout, donnent à ces situations une profondeur historique. Thierry Zarcone montre comment le culte des saints et des tombeaux est un courant majeur de l’islam, mais contesté comme « hérétique » par des courants islamistes ou considéré comme un phénomène social à contrôler par des gouvernements. « Repoussé à la périphérie de la dévotion islamique, loin d’un centre occupé par les mosquées, le culte des saints a toujours éveillé la suspicion et l’opposition de l’islam orthodoxe, autant que l’intérêt du prince et du politique en raison de son puissant ancrage dans les populations et de son fort pouvoir de mobilisation sociale. » (p. 45) L’islam des tombeaux ne laisse donc pas indifférent et suscite différentes stratégies politiques, allant du rejet pur et simple (et de la destruction) au patronage (p. 49). Une remarque de l’auteur retient aussi l’attention en fin de chapitre : ne restant pas cantonné au seul espace d’émergence de l’islam, le culte des saints et des tombeaux « commence à se manifester petit à petit dans les diasporas musulmanes d’Europe et des États-Unis » (p. 54).
Il revenait bien sûr à Stéphane Lacroix de se pencher sur le cas de l’Arabie saoudite comme « État prosélyte ». Il retrace l’évolution du rôle international de l’Arabie saoudite dans le champ religieux, mettant en évidence comment son prosélytisme religieux répond aux menaces du nationalisme et socialisme arabes dans les années 1960, puis au défi de l’Iran khomeiniste à partir de 1979. Cependant, ce prosélytisme saoudien ne se réduit pas à « une rationalité politique claire » et relève au moins autant « de la logique missionnaire des oulémas saoudiens que d’une ‘politique de puissance’ d’un État saoudien » (pp. 245-246).
Si elle a joué un rôle indéniable dans la salafisation de l’islam sunnite, l’Arabie saoudite n’en est pas la seule responsable : d’autres États se sont montrés bienveillants pour le salafisme dans l’espoir de voir un islam pieux contrer des courants activistes. Aujourd’hui, l’Arabie saoudite promeut seulement le salafisme dans sa forme puriste, mais le salafisme « s’est doté d’une existence propre » et son expansion actuelle ne s’explique que partiellement par l’influence saoudienne (p. 250).
Les durcissements qu’on peut observer dans des pays musulmans sont aussi la conséquence d’évolutions politiques et autres turbulences : ainsi, selon l’analyse de Bayram Balci, la tournure prise par les « printemps arabes » et, plus encore, la terrible crise syrienne ont largement poussé le gouvernement turc à s’orienter vers « un agrégat de nationalisme, d’islamisme et de néo-ottomanisme », même si ce soubassement idéologique demeure « flou et encore mouvant » (p. 147). Après les réformes initiales entreprises par l’AKP, la Turquie voit de plus un nationalisme religieux « s’impose[r] comme l’idéologie dominante » (pp. 141-142).
Religions et identités en Asie
En Inde, une hindouisation de la sphère publique bat en brèche des piliers du sécularisme de facto si ce n’est de jure, explique Christophe Jaffrelot : l’indianité se trouve définie « à partir de la religion dominante » (pp. 129-130). « L’Inde prend peu à peu le chemin de la ‘démocratie ethnique’ », avertit le chercheur, reprenant ici une formule « introduite dans le lexique des sciences sociales par des spécialistes d’Israël » pour désigner « un régime où l’accès aux droits citoyens est, en théorie, ouvert à tous mais où, en pratique, certains sont plus égaux que d’autres » (p. 137).

Cela n’empêche pas le gouvernement d’utiliser l’hindouisme, avec les clichés plutôt attirants qui y sont associés en Occident, comme instrument du soft power de l’Inde, ainsi que l’explique Jean-Luc Racine. Un bel exemple est celui de la journée mondiale du yoga (21 juin), instituée par les Nations Unies en 2015, « exercice de propagande culturelle » qui transmet un message politique : « l’Inde hindoue […] apporte au monde entier son savoir et sa sagesse millénaires » (pp. 64-65).
Le militantisme bouddhiste n’est pas nouveau en Birmanie, et l’hostilité de milieux bouddhistes aux musulmans non plus. En même temps, Renaud Egreteau souligne que le monachisme birman est loin de constituer « une entité cohérente et unifiée » (p. 347). Néanmoins, on est frappé par la capacité de ces militants bouddhistes à imposer certaines de leurs vues dans le débat politique, au point de faire passer des lois dans leur sens, ce qui montre que leurs revendications s’appuient non seulement sur un sentiment identitaire, mais aussi sur un ressentiment populaire dont l’auteur rappelle les racines historiques. L’une des conséquences du revivalisme bouddhiste est ainsi le « retour de l’islamophobie populaire et la réémergence de discours nationalistes exclusifs fondés sur l’identité religieuse » (p. 352).

En Chine, les statistiques officielles sur les religions sont en dessous de la réalité : selon des enquêtes non officielles, le pays compterait aujourd’hui plus de 300 millions de croyants, soit environ 31 % de la population adulte (p. 263). Si tolérance et répression coexistent en Chine, on peut identifier des dates marquant des inflexions de la politique religieuse. Ji Zhe et Vincent Gossaert en citent quatre depuis 1982, la dernière étant 2016, avec une réunion de travail sur les affaires religieuses à Pékin en présence de Xi Jinping. L’insistance de ce dernier sur la sinisation « n’a ici rien à voir avec la culture chinoise, mais doit être comprise comme la soumission au contrôle du P[arti] c[communiste] c[hinois] ». Les religions « risquent de se heurter à de nouvelles difficultés », concluent les auteurs (p. 270).
Les religions servent-elles à faire la guerre ?
Impossible pour un tel volume de ne pas se pencher sur la question du rôle des religions dans les conflits, tâche à laquelle s’attelle notamment Élise Féron. Dans les conflits actuels, la religion n’est jamais la seule explication, mais elle peut expliquer leur intensification, explique-t-elle d’emblée (p. 167). « En temps de conflit, les dimensions constitutives et structurantes des religions jouent un rôle de premier ordre dans la mobilisation des individus et expliquent comment elles favorisent le passage à l’acte. » Dans certains cas, elles peuvent sanctifier et légitimer la violence. Dans le sillage de travaux de Xavier Crettiez, Féron se penche sur « le lien très étroit qui existe entre religion et nationalisme » (p. 173).
Cependant, l’expression de « conflits religieux » se révèle en tout cas trompeuse : les conflits ainsi qualifiés « sont souvent causés par les mêmes facteurs socio-économiques, politiques, identitaires, etc., que les autres » (p. 170). De même, en Afrique, Cédric Mayrargue met en garde contre le risque de surinterprétation religieuse de conflits « [d]u simple fait de la place centrale occupée par des acteurs et des imaginaires religieux dans les sociétés africaines » (p. 360).
Les conflits peuvent aussi faire évoluer les religions dans leurs propres alignements et définitions. Le chapitre consacré par Laurence Louër aux ressorts internes et externes du conflit entre sunnites et chiites en fournit un frappant exemple au Yémen, avec la « recomposition radicale et rapide des relations interconfessionnelles sous l’effet de facteurs régionaux ». Représentant environ 40 % de la population, le zaydisme est historiquement une branche du chiisme (mais non aligné doctrinalement sur le chiisme iranien) ; cependant, explique Louër, « le développement du zaydisme sur plusieurs siècles témoigne d’un rapprochement doctrinal constant avec le sunnisme, qui s’accélère à partir de la seconde moitié du XXe siècle ». Le zaydisme se trouve alors de plus en plus perçu comme une branche du sunnisme, des individus de familles zaydites adhèrent à des mouvements sunnites. Dans les années 1980 émerge un courant revivaliste zaydite, dont un mouvement est celui dit houthiste (luttant notamment contre l’influence du salafisme en milieu zaydite) ; sa critique du gouvernement finit par déboucher sur une guerre civile. « Dès 2004, le gouvernement yéménite a disqualifié les houthistes, en en faisant des agents iraniens […], rapidement relayé en cela par les Saoudiens qui, en 2009, ont organisé une première intervention militaire anti-houthiste, lue par l’opinion publique arabe et internationale comme étant principalement destinée à contrer l’extension des réseaux d’influence iraniens au Yémen. Parallèlement, on constate à partir de cette période un processus de chiitisation et d’iranisation du discours et de la présentation de soi des houthistes […]. » Malgré le flou de leur identité religieuse et idéologique, les houthistes sont « renvoyés à une identité chiite par leurs adversaires » : reste à voir « si, après des années de convergence avec le sunnisme, le zaydisme connaîtra un véritable infléchissement vers le chiisme qui se manifesterait en particulier par une évolution des doctrines et une accentuation des différences avec le sunnisme. » (pp. 317-318)
Ce petit florilège d’observations sur une variété de sujets, glanées au fil des pages de Religion et Politique, suffit à illustrer un contenu à la fois solidement informé et pertinent pour la réflexion et l’analyse.
Jean-François Mayer
Alain Dieckhoff et Philippe Portier (dir.), L’Enjeu mondial. Religion et Politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2017, 368 p.