
En évoquant le djihad, vous parlez de mort «inutile». Pourquoi ce terme?
Cette mort souhaitée s’inscrit dans un certain nihilisme, très fréquent chez les jeunes d’aujourd’hui et que l’on pourrait appeler le «nihilisme du no future». En bref, c’est penser qu’il n’y a plus rien d’intéressant dans la vie actuelle, perçue comme une espèce de vide. Seule la mort garantit un accès à la «vraie» vie, à savoir le paradis. En effet, au moment où ils se tuent, ces jeunes sont convaincus de son existence. L’imaginaire des djihadistes est un élément essentiel pour mieux les comprendre. En ce sens, on peut parler d’islamisation de la radicalité.
Vous identifiez deux formes de nihilisme: l’un générationnel et l’autre millénariste; qu’est-ce qui les distingue?
Le nihilisme générationnel signifie que ces jeunes radicalisés sont en rupture avec leurs parents. Ils ne sont pas forcément en guerre, mais ils considèrent qu’ils n’ont plus rien à apprendre d’eux. Un peu comme s’il n’y avait pas de généalogie qui les précède, uniquement le néant. Autre phénomène curieux: ils font des enfants, mais ne les élèvent pas. Il n’est pas rare que les jeunes radicaux aient un bébé dans la même année que celle où ils passent à l’acte en se faisant sauter… Rien avant et rien après. Quant au nihilisme millénariste, même si l’expression n’est pas des plus heureuses, elle s’applique bien à ceux qui pensent que leur mort personnelle est un signe avant-coureur de l’apocalypse. Ils réfutent l’idée de l’établissement d’une société islamique dans la durée. Leur action est donc considérée comme un des présages de la fin des temps.
Cette même configuration terroriste serait-elle possible dans une autre religion?
En ce moment, non. La situation est clairement liée au contexte social et géostratégique du Moyen-Orient. Si l’on prend un cadre différent, par exemple celui des évangéliques aux Etats-Unis, on voit très bien comment des têtes brûlées qui ont envie de faire la guerre deviennent pilotes dans l’US Air Force. Une autre possibilité leur est offerte. La réalité reste cependant complexe et il ne faut pas perdre de vue que le salafisme n’est pas forcément le sas d’entrée du terrorisme.
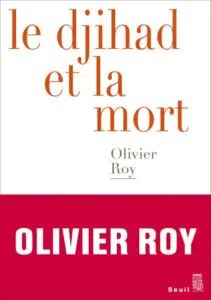 A la fin de votre ouvrage, vous posez la question «pourquoi Daech tient-il?», avez-vous une réponse à proposer?
A la fin de votre ouvrage, vous posez la question «pourquoi Daech tient-il?», avez-vous une réponse à proposer?
Cela tient en peu de mots: chaque ennemi de Daech a un pire ennemi que Daech. Les acteurs sont paralysés parce qu’ils craignent que la disparition de Daech favorise leur autre ennemi. Tous considèrent également que Daech est un épiphénomène, mais que l’autre ennemi, lui, sera toujours là. Les Turcs pensent que les Kurdes sont un problème; les Kurdes sont convaincus que ce sont les Arabes; les Saoudiens prétendent que c’est l’Iran; pour l’Iran ce sont les Soviets, et ainsi de suite. On le voit bien avec Mossoul: pourquoi n’y a-t-il pas d’attaques? Depuis quelques années déjà, nous constatons l’émergence d’un djihad global, international, détaché de tout contexte national et principalement individuel. Grâce à une communication prônant l’esthétisme de la mort et la victoire de la terreur, Daech offre le cadre idéal à la concrétisation d’un tel imaginaire.
En Europe, qui sont ces jeunes et qu’est-ce qui les pousse à un choix aussi extrême?
Même s’il faut tenir compte des variations entre les différentes nationalités, nous sommes actuellement en mesure d’établir le profil type du jeune radicalisé. En France, par exemple, on constate que, sur vingt ans, les profils sont restés très similaires: deuxième génération, bien intégrés, parcours de petits délinquants, radicalisation la plupart du temps en prison, passage à l’acte sous forme d’attentat, mort sous les coups de feu de la police, l’arme à la main ou dans l’explosion. Qu’ils soient musulmans d’origine ou convertis, presque tous les terroristes sont des born again, à savoir qu’après avoir connu une vie plutôt profane, voire dissolue, les jeunes retrouvent une pratique religieuse plus stricte. Il faut préciser que la plupart passent à l’acte après avoir donné des signes de radicalisation. Il n’est pas rare non plus que des frères, des amis, des cousins suivent le même parcours et agissent ensemble. La seule évolution notable est le nombre croissant de femmes djihadistes.
Existe-t-il des signes auxquels les familles et les proches devraient être attentifs?
Actuellement, des milliers de signalements arrivent à la police, preuve que les parents surveillent de près leurs enfants. Il existe pourtant une grande confusion entre radicalisation religieuse et terroriste. Dès que quelqu’un présente des signes d’entrée en religion, il est dénoncé comme potentiellement dangereux. Dans la réalité, ce n’est pas aussi simple. L’intensité de la pratique ou de la foi n’est pas un gage d’extrémisme.
La déradicalisation, vous y croyez? Avez-vous des pistes à proposer?
Il faut d’abord se poser la question de la nature de la radicalisation: est-elle psychologique, théologique ou relève-t-elle d’une incompatibilité entre islam et Occident? En fonction de la réponse, les solutions à envisager sont différentes. Pour moi, il n’en existe pas un nombre infini. Une possibilité serait l’isolement des radicaux du reste de la société, à commencer par la société musulmane. Il faudrait faire en sorte que les frustrations ne se canalisent pas vers le terrorisme. L’inconvénient de centres comme ceux mis en place en France est qu’ils partent de l’idée que la radicalisation est une forme de pathologie et que les jeunes ne savent pas ce qu’ils veulent. C’est tout le contraire, ils sont fascinés par la radicalité, ils la cherchent. Comparer le djihadisme à l’alcoolisme me paraît complètement inutile. Il faut être conscient que la déradicalisation est plus un moyen d’aider les familles que les jeunes radicaux. Ce concept permet d’innocenter les parents en leur faisant comprendre qu’ils ne sont pour rien dans le choix de leurs enfants, que leur fils ou leur fille sont en fait malades et qu’ils vont être guéris.
Olivier Roy, Le djihad et la mort, Paris, Éd. du Seuil, 2016, 172 p.
© 2016 Unicom – Université de Fribourg.
Une version légèrement plus longue de cet article a d’abord été publiée le 21 octobre 2016 dans Alma & Georges, magazine en ligne de l’Université de Fribourg. Nous remercions la rédaction d’Unicom, service Communication et Médias de l’Université de Fribourg, d’avoir autorisé Religioscope à reprendre ce texte.